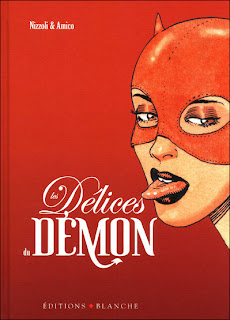Résumé : " Je n'en reviens pas, Renarde, que tu ne sois pas morte, et si
aujourd'hui aucun mot d'amour ne te vient, cherche, trouve autre chose,
je ne te laisserai pas un seul jour de silence, pas un seul jour sans
réclamer, pour mon usage, les mots que tu me dois, trouve, trouve, et si
ta terre est vide, désertée de gibier, marche, cours, va-t'en tuer
ailleurs, ramène-moi mon dû, car tu es à moi jusqu'à user ton être,
jusqu'à toucher la trame, pour autant que tu en aies, car c'est ce que
je veux, vérifier la trame, le dessin qui te guide malgré toi quand tes
sens et ton intelligence seront morts. "
Un homme et une femme vivent
une passion singulière, aussi ritualisée qu'extrême. Le récit d'une
emprise et de sa subversion.
Une longue usure du rapport Dominant/Soumise constitue la trame de ce roman, puisqu'il s'agira de partir du frémissement par non-respect d'un ordre du Maître sur la Soumise, appelée Renarde par celui-ci, jusqu'à l'abandon par le Maître. La femme se veut ici dans une soumission quasi-totale, puisque seuls en réchappent, selon le contrat établi entre eux deux, la part familiale et la part professionnelle, parts qui ne seront jamais abordées dans le récit, laissant planer le sentiment d'irréalité qui peut, en soi, peut-être être contestable.
En effet, cet aspect renforce le sentiment d'un univers fantasmé sans prise avec le quotidien existant - qui ne doit bien sûr pas être automatiquement annihilant - touchant un enfer onirique et cruel autour duquel évoluerait le tout-chacun, inconscient des jeux sadiques et masochistes qui se déroulent non pas sous ses yeux, puisque la plupart des scènes se passent en intérieur, chambre d'hôtel et donjon inclus, mais dans son quotidien sensible, à fleur de peau. L'exhibition est donc exclue sauf devant initiés, contrairement au livre "Le Professeur", où la réalité est d'ailleurs transcendée pour risquer le vide d'un happement hors de soi, hors de contrôle. Or, si dans "Le Professeur" de Christian Prigent une forme de respect et d'amour existent entre les personnages, touchant parfois à l'admiration de la part de l'homme vis-à-vis de la jeune fille, il est question ici d'une absolue humiliation, à laquelle se soumet de plein gré mais rarement dans la joie la jeune femme de ces "Carnets". Il s'agirait presque d'un besoin obsédant, à la fois rejeté instinctivement par sa violence d'expression, et recherchée à tout instant sous une forme quasi-addictive. Une soumission qui flirte en permanence avec le rejet de sa condition, néanmoins nécessaire à son sentiment d'existence. Son amour pour son Maître possède la puissance propre à la fascination de la tyrannie, lui permettant de ne plus penser et ne plus être que la forme d'expression du Maître, avec quelque sursaut de bête perdant son absolue liberté lorsqu'elle réclame l'arrêt définitif des coups, ou bien la séparation.
Le principe de Domination/Soumission est donc exploré dans une forme extrême où il s'agit d'empêcher (de détruire ?) la capacité de penser hors du Maître - même si elle nous transmet sa pensée, mais pensée aliénée par le sentiment de devoir de possession - et de se sentir réduite à l'état d'objet oscillant entre l'érotisme (le corset, la jupe de papier, symboles de séduction) et un sentiment de déchet, que le chapitre de la sodomisation suivie du léchage des filets d'excréments sur le sexe symbolisent, le Maître dressé et forçant sa Soumise à lécher tout en profondeur, l'observant froidement vomir sa bile ensuite.
En constatant cela, je ne peux que songer à différents parallèles avec, de nouveau, "Le Professeur", puisque le chapitre où la jeune élève mange la merde de l'homme constitue un acte d'amour : la jeune fille déguste, fourre son nez presque avec gourmandise tout en étant remplie d'un dégoût spontané, et il s'agit là de dépasser l'acte lui-même et d'accéder à la part assombrie de l'être et de l'inciter à constamment se dépasser en l'exposant à travers la réalité : tendre vers le trou de l'être, la langue (écrite) transformant le tout en acte érotique, le regard et la queue de l'homme vibrant d'amour. Ainsi, la jeune fille domine, implicitement, sous la suggestion du professeur. Ici, la femme n'est qu'acte de dégradation continue, privée de tout espace afin de ressentir le joug de sa soumission dans une froideur absolue de l'homme (l'amour qu'il doit avoir pour elle ne semble relever aussi que d'une addiction vis-à-vis de la possession) qui ne s'émeut que lorsqu'il ressent un doute quant à la remise en cause de sa domination, craignant que Renarde ne lui échappe (la maison de passe, etc.) et se rassurant surtout en lui demandant témoignage constant de son état : les messages répétés chaque jour, les écrits, la menace et la mise en pratique sous-entendue de prise d'autres soumises, entretenant le possible rejet d'une Renarde vieillissante et usée.
La dégradation atteint, à mon sens, son summum lorsqu'il la sodomise à sec dans son sommeil, après s'être moqué de son éducation et de son statut de juive.
D'ailleurs, l'auteur rassurerait-elle le lecteur en évoquant plus loin le fait qu'il fut lui prisonnier et torturé de guerre ? N'est-ce pas trop facile, comme un présupposé de vécu justifiant la recherche d'une telle relation ? Cela est fort dommage, puisqu'elle confère un statut particulier psychologiquement et historiquement chargés, évinçant toute autre situation ne répondant pas à ce vécu "unique" et particulier. Le BDSM apparaît alors ici comme résultat d'un vécu hors-norme (la religion, juive notamment, offrant son poids de vécu même si non personnellement). Elle conforte mon idée d'un homme ne cherchant aucunement le plaisir de sa partenaire (partenaire car il s'agit de deux adultes consentants, la femme étant libre de partir à tout moment) mais usant et abusant de cette voie recherchée par cette femme pour satisfaire uniquement son plaisir propre. Certes, il lui en donne régulièrement, au début (n'oublions pas, par exemple, que le fait d'interdire de prendre du plaisir donne aussi du plaisir), mais cela s'en ressent comme d'une coïncidence bienheureuse pour elle : son but à lui est seulement lui, et j'aurais tendance à dire que cela fausse l'image du rapport Domination/Soumission, puisque même à travers l'humiliation et la dégradation, ne doit-il pas exister d'abord une forme de respect et de prise en compte de l'autre ? Dans cet ouvrage, le Maître ne cherche pas à prendre en compte, je pense, sa Soumise, mais à l'optimiser pour qu'elle soit à son goût, quelles qu'en soient les conséquences, jusqu'à lassitude. Trois aspects tendant à conforter cette idée, les deux premiers sous forme d'extraits :
" - Je ne vais pas bien, Renarde. J'ai envie de te battre.
Je suis là pour ça. Être battue pour que vous alliez mieux. Absorber la colère causée par d'autres ou par vos propres démons. Ma faim d'humiliation vous apaise, mon désespoir lorsque vos gifles me cassent [...]. Cette rage triste ressemble à la vôtre quand, asocial, vous menacez votre entourage et ruinez votre réputation."
" - Je pourrais te tuer, Renarde."
Pourtant, cet homme la maîtrise parfaitement au fond de son être et cerne toutes ses pensées et ses libertés potentiellement à venir. Il la sonde et l'immobilise en tout, perfectionnant le contrôle et la possession absolue de cet être dont le but est d'être objet. Objet tant usé que la lassitude s'installe, ressentie et crainte par la femme, que les jeux s'épuisent, et que la maladie occasionnelle (troisième aspect annoncé ci-dessus) finit à briser tout lien de lui à elle, l'éloignant de corps, puis d'esprit. La dégradation est totale car la fatigue qu'il ressent à son égard est là, il la "lime" jusqu'au bout de l'inutilisation mentale. La soumission serait absolue peut-être dans le symbole si la soumise mourrait d'abandon sans se nourrir ni boire, mais le récit finit par le plaisir mental que ressent la soumise à l'évocation de son Maître et la simulation de sa présence par l'acte qu'elle s'autorise. Est-ce vouloir terminer de manière donc positive, en laissant entendre la force de soumission qui la pousse à continuer à vivre, ne serait-ce que dans l'idée-même qu'elle s'en fait ? N'est-ce pas offrir une contradiction avec le reste, évitant l'écueil possible du pathos de la mort ? Est-ce suggérer la part humaine, toujours en mesure de pouvoir s'exprimer ?
Ce récit me laisse donc pleine d'interrogation et de craintes, tant il cherche à puiser dans la violence extrême des tabous de liberté brisée, par consentement certes, mais le consentement est-il toujours l'expression d'une liberté, ou ne peut-il être aussi l'annihilation de l'individu par son contrôle total, lui donnant l'illusion d'une liberté, comme cela me semble être le cas dans ce récit ?
La qualité littéraire du texte est de facture assez classique et sans grand intérêt de forme si ce n'est que de souligner et affirmer la position de chacun (notamment les interpellations brutales du Maître, et dont on ne connaît la pensée), quoique la Renarde, qui écrit ces carnets pour son Maître, pratique l'ironie (que le Maître apprécie mais ressent comme une faiblesse dans son contrôle, sorte de paradoxe dans lequel on le sent dépassé, ainsi que dans la scène de présentation du sexe non épilé - encore une "tradition" souvent non remise en cause en BDSM, celle que de devoir être parfaitement épilé... mais cela est un autre sujet), ce qui dénote sa possibilité à s'émanciper à quelque moment que ce soit ; mais l'ironie demeure vite passagère. Un piment de jeu pour elle, inconsciemment, sous couvert de ?
Quelques clichés aussi dans le comportement, les préjugés (pour la Renard, le poids de son éducation visant les rapports homme/femme, le souhait du mariage, etc.), le positionnement homme/femme avec leur sexualité propre.
L'intérêt me semble donc résider dans le bousculement intime et social d'une variante de la pratique BDSM correspondant à une image pourtant un peu clichée par son caractère ici extrême psychologiquement et ce, d'autant plus au quotidien. Image réaliste mais non ancrée comme étant LA pratique, puisqu'il existe toute forme possible de BDSM, permettant d'insister sur le fait que cette lecture doit s'allier à d'autres, afin d'élargir un point de vue. Ce point de vue ne se verrait sinon que conforté, n'explorant pas les voies qui peuvent amener à cette pratique. Ceci est somme toute aussi logique pour cet ouvrage, qui cherche à nous faire ressentir ce que ressent Renard, avec la même violence psychologique.